Auteur : ECRIREUNLIVRE
Date de création : 23-11-2022
L'ÉCRITURE
Si l’on s’en tient au cheminement de l’écriture, il est possible de prétendre que la rédaction d'un livre est, en soi, un défi qui se mesure au nombre de pages remplies.
Comme pour un vrai cheminement, de randonneur par exemple, on trouve un point de départ et un point d’arrivée. Il serait une erreur de croire qu’un auteur – comme d’ailleurs un randonneur – dispose de la liberté de s’arrêter définitivement à n’importe quel endroit, dès lors qu’il sent venir l’épuisement. S’arrêter avant d’avoir atteint son objectif, dans l’écriture d’un livre comme dans la marche, n’est rien de plus qu’un aveu d’échec.
Cela veut-il dire qu’il est impossible d’envisager un texte plus réduit, en cours d’écriture ? Ne nous égarons pas… tout remaniement est possible, mais écourter son livre, même quand il ne s’agit pas d’une fiction, revient généralement à modifier le projet initial.
Précédemment, j’ai évoqué le terme d’engagement. Ce terme peut paraître curieux dans le contexte de l’écriture. Pour s’engager, ne faut-il pas être plusieurs ou au moins deux ? Auquel cas, comment l’auteur, seul face à ses pages blanches, peut s’engager ? Il le fait, néanmoins, vis-à-vis d’un lectorat qui, bien qu’encore imaginaire (lui aussi), doit être envisagé. Le sujet qui n’écrit que pour lui-même, évince une étape essentielle, qui est la communication.
Écrire, c’est aussi communiquer. Voilà pourquoi l’auteur devra veiller, tout au long de son cheminement « rédactionnel », à maintenir l’attention du lecteur. Cette tâche est d’autant plus difficile, de nos jours, que le lecteur actuel est souvent exigeant et capricieux. (Pas tous heureusement). Habitué aux zappings, gavé de vidéos, toujours avide de nouveautés, impatient devant les temps morts… ce dernier aura une préférence pour les histoires dynamiques, avec actions, sensations et émotions fortes. L’auteur n’est pas, non plus, obligé de l’écouter et de se soumettre à ses attentes, qui ne sont toujours de bon goût. Mais quelques petites méthodes d’écriture peuvent avoir leur utilité.
Ces méthodes vont m’amener à vous transmettre quelques connaissances de mes (lointaines) études de Lettres modernes avec pour module, théâtre et cinéma.
L’intrigue
D’abord, posons-nous la question : une intrigue est-elle toujours nécessaire dès qu’il s’agit de raconter une histoire ?
On peut croire que « oui » si l’on se fie aux modèles existants de littérature à travers les âges. On trouve des intrigues dans la mythologie antique, dans les œuvres d’Homère, chez Corneille ou Victor Hugo… Il ne s’agit donc pas d’un phénomène de mode.
Les polars se présentent, généralement, comme les romans les plus aptes à cultiver le mystère de l’intrigue, mais ils s’exposent aussi au risque de tomber sur une enquête bateau du genre : une jeune fille a disparu ; on découvre qu’on ignorait son passé et l’enquêteur qui soupçonne plusieurs membres de son entourage, commence, bien sûr, par faire fausse route. Très probablement, un des personnages s’appellera Anna et un autre Johnny. Même dans le choix des prénoms on peut friser la banalité ! Mais certains policiers prennent le contre-pied du schéma classique d’une intrigue qui consiste à deviner qui est le meurtrier. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu’il n’existe plus d’intrigue. Celle-ci change, simplement, en obligeant le lecteur à se poser de nouvelles questions comme : « De quelle manière l’enquêteur va pouvoir piéger le meurtrier ? ; Va-t-il y avoir une justice ? », etc. Il est également possible d’envisager un changement d’intrigue en cours de récit. Par exemple, le lecteur découvre le visage de l’assassin au milieu de l’histoire et se demande ensuite s’il ne risque pas de récidiver…
On n’y pense pas toujours, mais l’humour peut également servir à construire une intrigue. Par exemple, l’auteur détaille des scènes qui annoncent une situation cocasse.
Une question énigmatique, telle la célèbre énigme que le Sphinx pose à Œdipe, une devinette, une charade ou encore un rébus peuvent également servir d’intrigue dans un récit.
L’intrigue est ce qui permet de retenir l’attention du lecteur. L’auteur esthète qui souhaite se passer d’une intrigue devra donc compenser en proposant soit des réflexions philosophiques, comme dans le conte philosophique, soit des connaissances qui proviennent d’un travail d’investigation ou de recherche dans un domaine particulier.
D’une manière ou d’une autre, l’auteur doit devancer le lecteur. Une histoire cousue de fil blanc et qui n’apprend rien ne va pas intéresser.
Il suffit déjà de mesurer la difficulté que cela représente pour un discours oral. Combien d’hommes politiques (ou autres), qui se lancent dans de longs laïus, parviennent à capter l’attention de leur public ?
Lire un roman, revient à laisser la parole à un même individu pendant trois, quatre, cinq heures voire beaucoup plus parfois.
Écrire exige peut-être un talent, mais aussi un savoir-faire et des connaissances dans le domaine littéraire.
Le XXIe siècle est l’un des rares siècles de notre histoire à ne pas développer d’écoles de la littérature. Par « écoles », on évoque un genre littéraire, mais aussi un ensemble de savoirs né d’échanges et de réflexions que des auteurs aguerris transmettent aux jeunes générations. Nous avons perdu ce modèle de transmission, le livre devenant davantage un produit de la consommation qu’un bien culturel.
Faute de connaissances, bien des auteurs vont recourir à des évocations destinées à provoquer, à exciter ou à horrifier le lecteur. Mais une fois l’effet produit, que reste-t-il d’intéressant à raconter ?
Déjà, l’intrigue ne doit pas être considérée comme d’un seul tenant. L’auteur peut, dans un premier temps, éveiller la curiosité du lecteur par certains détails (indices), puis (dans un second temps) susciter une vive émotion et (dans un troisième temps) relater le début d’une action/intervention. On connaît cette expression : « la grande scène du deux ». Sous-entendu « du deuxième acte d’une pièce de théâtre », moment où les personnages devaient émouvoir le public. L’erreur, actuellement, serait de vouloir tout placer dans l’accroche, soit le début de l’histoire : l’émotion, le mystère et l’action (tant pis si ça fait trop lourd) et l’enjeu serait ensuite de maintenir le plus longtemps possible, au fil des pages, les effets de l’accroche. Au final, les artifices utilisés pour maintenir l’attention prennent le dessus sur l’histoire.
Il s’agit de voir, à présent, par quelles solutions il est possible d’éviter ces artifices.
Les axes d’une histoire
Sur l’axe syntagmatique, on observe une histoire, telle qu’elle se déroule dans le temps, avec la linéarité des faits et des événements qui se suivent selon une chronologie.
Sur l’axe paradigmatique, il s’agit cette fois, d’une lecture verticale, qui tient compte notamment des signaux répétés, des symboles apparents et des mouvements qui rythment l’histoire.
Par exemple, l’histoire relate le cycle des quatre saisons. C’est l’axe syntagmatique. Dans ce récit, on rend compte à chaque fois de l’état d’un même arbre qui a tantôt des feuilles vertes, tantôt des fruits, ou ses feuilles jaunissent, ou il les perd. C’est l’axe paradigmatique.
L’exemple visuel que propose un film est sans doute plus éloquent. Prenons Les Oiseaux d’Hitchcock. Le scénario du film, tel qu’il se déroule correspond à l’axe syntagmatique. Concernant l’axe paradigmatique on a : les oiseaux sur les fils électriques ; les fils électriques sans les oiseaux ; le moment où les oiseaux arrivent sur les fils ; le moment où ils quittent les fils pour attaquer, etc.
Parfois, l’axe syntagmatique s’avère totalement distinct du fil de la narration. Il est régulièrement fait allusion à un lieu, à un objet ou à un événement sans que le lecteur comprenne le sens de cette insertion dans l’histoire. Il le découvrira, évidemment, dans les dernières pages.
L’axe syntagmatique peut être encore la répétition d’une porte ou d’un volet qui claque ; de journées ou nuits orageuses, avec des éclairs qui traversent le ciel. En prenant en compte cet axe vertical, l’auteur peut ainsi accentuer un suspense et créer une atmosphère.
Les histoires à multiples subjectivités
Les flash-backs et déplacements dans le temps
Les histoires à tiroirs
La mise en abyme
L’effet de vraisemblance, il va de soi, peut aiguiser la curiosité du lecteur (à condition bien sûr que l’histoire ait un vrai intérêt et aussi que le lecteur soit assez curieux !), mais quelles méthodes employer pour accentuer un effet de vrai, aux point de laisser le lecteur dubitatif ?
Bien des écrivains n’ont pas attendu notre époque pour se poser la question. Les courants du réalisme et du naturalisme ont été, au XIXe siècle, des réponses qui ont été trouvées à ce genre de question.
Le réalisme et le naturalisme
La naissance du réseau ferroviaire avec l’apparition des premiers trains vapeur a fait naître, dans la population, un certain nombre de psychoses. On croyait, par exemple, que le seul fait de voir des trains passer, pouvait rendre fou en raison de leur vitesse (estimée considérable à l’époque). Dans La Bête Humaine, Émile Zola exploite le filon pour ainsi dire. Son personnage qui voit passer un train sous ses yeux, aperçoit une scène de crime par la fenêtre d’un wagon. Alors, fou ou pas fou ?
Évidemment, pour nous qui avons été habitués à voir filer des TGV sans craindre pour notre psychisme, mais aussi sans aucune opportunité possible d’y apercevoir une scène de crime, l’effet de vraisemblance n’agit plus. Mais ce n’était pas le cas au XIXe siècle.
Pour obtenir un effet de vraisemblance, l’auteur doit donc donner naissance à des personnages sensibles qui aiment ou haïssent, souffrent ou exultent. Le protagoniste arrive dans un nouveau lieu : il est impressionné. Il vit un événement rare ou imprévu : il est bouleversé, etc.
Au XIXe siècle, les livres ont encore un rôle politique (au sens large du terme). L’auteur se sert de la fiction pour dénoncer des injustices et des abus de pouvoir. Le réalisme va devenir, en cela, un outil d’expression.
Le personnage détaille la réalité brutale et crue, telle qu’elle se révèle à ses yeux. La dimension subjective est précisément ce qui distingue le « réalisme » du « romantisme ». Le personnage, à travers ses descriptions, donne une impression d’objectivité, mais il s’agit d’une fausse objectivité, puisqu’elle émane d’un ressenti propre à son témoignage.
Un autre courant vient s’ajouter : « le naturalisme ». Cette fois, l’auteur se transforme en un journaliste enquêteur. Il effectue un travail d’investigation précis dans un milieu déterminé, ceci pour les besoins de la narration qui, non seulement décrit des scènes, mais détaille des modes de vie conformes à une réalité contemporaine. L’effet de vraisemblance est alors entretenu par le mélange entre écriture romanesque et écriture journalistique. Le lecteur ne parvient plus à distinguer ce qui est proprement informatif de ce qui est fictif.
En guise d’exemple, le premier paragraphe de Robinson Crusoé dont les présentations sont pour le moins perturbantes par leurs précisions :

Le récit engagé : le coup de gueule et l’imaginaire en un livre
Aujourd’hui, il vient très peu souvent à l’esprit que le mode imaginaire peut également servir à défendre des idées. Nous pouvons pourtant, à ce sujet, retenir cette parole d’Einstein : « L’imagination est plus importante que le savoir. »
Cette dichotomie actuelle entre une fiction qui ne s’appuie sur aucune réalité sociale et les écrits d’un essai qui s’en tient à des informations authentiques, mais parfois rébarbatives, risque finalement d’appauvrir les deux genres.
Le texte pamphlétaire peut avoir pour inconvénient, quant à lui, de paraître trop agressif.
Il peut donc y avoir une certaine habileté, de la part de l’auteur qui souhaite exprimer son coup de gueule, de se servir des atouts de la fiction pour mieux faire avaler la pilule, le genre fictif lui permettant aussi de se protéger contre d’éventuelles attaques. Il reste que la fiction, de nos jours, n’est souvent rien de plus qu’un moyen pour se distraire et s’évader. Il n’est donc pas certain, non plus, que le message puisse mieux passer par ce biais.
Changer le monde avec Malraux
Je vais aussi essayer de faire simple, car les réflexions de ce théoricien de l’art s’avèrent particulièrement creusées.
Partons d’une de ses citations : « L’art est un anti-destin » mystérieuse, comme le reste de ses discours théoriques (la plupart, du moins).
Qu’est-ce qu’il entend par là ?
Tout d’abord, André Malraux a constaté que l’art a un pouvoir de communion.
Pour expliquer son constat, commençons par un exemple ordinaire :
Plusieurs personnes de différents bords politiques sont installées autour d’une table. Vous rejoignez les attablés et commencez par lancer quelques sujets de société, sur un thème du genre : le réchauffement climatique, les grèves, les migrants ou mieux encore, les Roms installés en France ou les musulmans sans papier. Si les discussions se poursuivent, à moins que quelqu’un les interrompe en déclarant un truc du style : « Au fait, il est chouette ton pull ! Il est neuf ? Tu l’as acheté où ? » Il ne sera pas nécessaire d’attendre une heure pour constater que les discussions virent au pugilat verbal, avec forcément des paroles vives et agressives entre les convives qui mettront un terme (définitif ?) à la (fausse) bonne entente !
C’est donc le genre d’expérience que je déconseille vivement un soir de réveillon.
Ce constat établi, l’écrivain théoricien en déduit que l’art dispose d’un pouvoir d’influence et propose une solution pour utiliser cette influence.
Laquelle ?
À partir d’une formule. La voici. L’auteur (ou scénariste) à travers son récit, doit lui-même opérer un changement dans la destinée de ses personnages, mais ceci d’une manière méthodique.
Tout d’abord, en se basant sur le contexte social réel, l’auteur procède à une sélection : il choisit un individu qu’il considère comme victime de la société, puis repère la personne qui pourrait correspondre à son « bourreau » (au sens propre ou figuré du terme). Enfin, il tente de voir quelle est la personnalité que la société protège et adule comme un « héros ».
Ces individus définis, l’auteur va devoir procéder aux changements suivants dans le cadre de la narration : la victime réelle devient le héros de son histoire. Le héros, lui, prend la place de l’opposant (le bourreau), quant à l’opposant réel, il prend la place de la victime. Ainsi, peut naître une histoire qui contribue au changement des destinées.

La catharsis grecque
Pour les philosophes et artistes grecs de l’Antiquité, à l’origine des problèmes de civilisation, il n’existe qu’un seul mal, ce sont les mauvaises passions. Si les mauvaises passions se développent dans la population, c’est parce que des individus souffrent de carences éducatives et ont été trompés par des discours ou des artifices, de sorte qu’ils en viennent à ignorer leurs propres désirs.
Mais l’art théâtral vient au secours des mauvaises passions en démontrant que l’accomplissement d’un désir ignoré a des conséquences et évidemment… ça tourne mal, très mal même. Ainsi le spectateur commence par vouloir ressembler au héros (joué sur scène) qui a les mêmes désirs que lui, mais plus le personnage réalise ses désirs, plus il s’empêtre et se compromet… jusqu’au dénouement fatal, celui d’une tragédie.
La leçon de morale est claire : voilà ce qui arrive si les lois de la cité laissent les individus donner libre cours à de mauvaises passions. Leur vie deviendra une tragédie. De quoi obliger le spectateur à quelques remises en cause.

S’interroger sur les limites
Quelles sont les limites qu’il donne à l’espace ? Au temps ? À ses personnages ?
L’espace – Où se passe l’histoire ? Dans une ville, un village ? Le lieu peut être encore plus exigu : une maison, une pièce, un cagibi… et pourquoi pas la poche d’un utérus ? Ou beaucoup plus vaste : un pays, un continent, la planète, l’espace intersidéral… et pourquoi pas aussi le monde de l’Au-delà ?
L’espace est-il figé ou mobile ? Est-il banal ou original ? Est-il habité ou désert ? Est-il accueillant ou hostile ?
Le temps – À quels moments se déroule l’action ? Elle peut avoir lieu des siècles ou des millénaires avant, ou après notre époque, et pourquoi pas les deux ? Mais le narrateur peut aussi vouloir nous expliquer ce qu’il a fait la minute d’avant.
Comment s’écoule le temps ? Les événements peuvent se produire en accéléré, ou au ralenti. Et pourquoi un temps qui se fige, comme dans le conte de la Belle aux Bois dormants ?
Quels sont les personnages ? – Sont-ils réels ou fictifs ? Sont-ils célèbres ou connus de personne ? Sont-ils bons, mauvais, ou encore à double personnalités ? Ont-ils des dons ou des tares ? Sont-ils beaux ou laids ? Viennent-ils de l’étranger, d’un monde moderne ou sauvage, ou encore d’une autre planète, comme le Petit Prince ? Dans quel milieu social ils évoluent ? Quel est leur tenue, le soin qu’il donne à leur apparence ? Sont-il nombreux ou n’y a-t-il qu’un personnage isolé ?
Etc.
Il est important, pour l’auteur, de savoir s’affranchir de certaines barrières (éducatives ? psychologiques ?) L’écriture offre une liberté incomparable ; face à une page blanche, il est possible de tout inventer et de tout dire (du moins, presque tout) : il faut en profiter !
Cette remarque est déjà significative du rôle de l’imaginaire au cours de la phase d’écriture. Ce n’est pas parce qu’il écrit que le romancier ne continue pas à imaginer et… c’est l’imagination qui guide l’écrivain, plutôt que le contraire.
Ensuite, c’est une logique attendue. Si l’écrivain connaît dès les premières pages, l’achèvement de son histoire, alors ne doit-il pas s’attendre à ce que le lecteur le devine également ?
Autrement dit, plus l’auteur se laisse surprendre par l’idée d’un dénouement et plus cela pourra être le cas du lecteur.
J’avais prétendu, dans un article précédent, que les fins de romans, beaucoup moins importantes sur le plan commercial que l’accroche du premier chapitre, ont tendance à être bâclées… mais ce n’est pas toujours le cas. Des éditeurs restent très attentifs à la manière dont l’histoire s’achève et vont vouloir également jeter un œil sur la fin (après la lecture du premier chapitre). Et pour cause : il y a souvent nécessité d’aller jusqu’au bout pour savoir si l’histoire tient. C’est aussi avec la fin que peut se révéler le vrai sens de l’histoire.
Si la première phrase d’un livre s’appelle « l’incipit », la dernière se nomme : « l’explicit ». Un terme en soi révélateur, n’est-ce pas ? Cela ne sous-entend-il pas que le fin fond de l’histoire peut être uniquement révélé à la dernière ligne ?
Outre la question de l’espace laissé, en fin d’histoire, au dévoilement de l’intrigue, il est encore possible pour l’auteur de s’interroger sur les différentes dénouements envisageables afin d’éviter la redoutable fin en queue de poisson.
Voici un inventaire des différentes options possibles :
– Fin en boucle, qui ramène le lecteur au début de l’histoire.
– Une évolution incertaine : on ne sait pas si le personnage atteint son but ou pas, certains détails le laissant croire et d’autres non.
– Un retournement de situation de dernière minute, par la mort (inattendue) d’un personnage, un incendie, une explosion, une tempête, la disparition d’un objet essentiel…
– Un happy end ou au contraire, une chute.
– Une révélation aux autres personnages ou au contraire l’enfouissement (définitif) d’une vérité essentielle. (Seul le lecteur sait, ou le lecteur et un des personnages.)
– Un effet papillon : l’événement entraîne une réaction en chaîne, qui génère des conséquences (positives ou négatives) dans un autre domaine (ou secteur), ou chez d’autres personnes… voire sur l’échelle sociale ou planétaire.






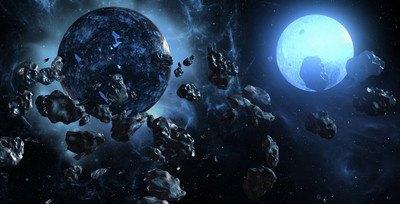





Commentaires
Bravo pour la photo du jour